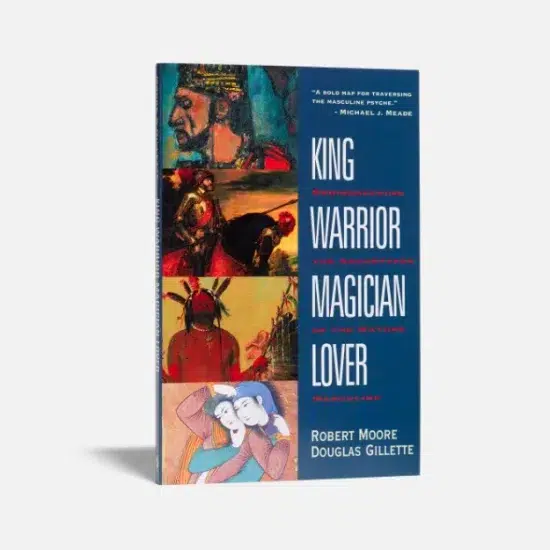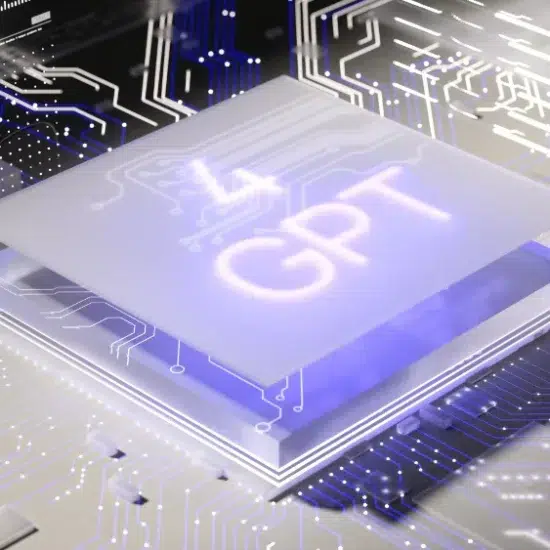Nous pensons être modernes, mais nous raisonnons comme au XVIIIe siècle
Nous nous croyons à la pointe du progrès, baignés dans un monde ultra-technologique. Pourtant, si nous devions mesurer le niveau de connaissances du citoyen lambda, nous découvririons une réalité troublante : nous raisonnons encore avec des concepts vieux de plusieurs siècles.
Prenons l’enseignement des sciences au gymnase/lycée. On y apprend la mécanique de Newton (1687), les bases de l’optique classique, l’électricité de Maxwell (1865), la chimie de Lavoisier (1789). La relativité restreinte ? Évoquée, si l’on a de la chance. La mécanique quantique, qui gouverne pourtant toute les sciences modernes ? À peine mentionnée.
En d’autres termes : notre grille de lecture du monde repose sur des théories du XVIIe au XIXe siècle, alors que la physique a complètement changé de paradigme depuis un siècle. Et ce phénomène ne concerne pas que les sciences dures.
- En économie, on applique encore des modèles classiques issus du XIXe siècle à un monde où les cryptomonnaies, l’intelligence artificielle et les algorithmes financiers pilotent des milliards d’échanges par seconde.
- En biologie, on apprend l’ADN au lycée, mais combien de personnes comprennent vraiment l’épigénétique, ou même les révolutions en cours sur la longévité et la biotechnologie ?
- En philosophie et en sciences sociales, on continue à structurer la pensée autour de débats qui datent de l’ère industrielle, alors que l’intelligence artificielle et les crises modernes nous obligent à repenser l’identité humaine, la valeur du travail et la notion même de conscience.
Nous ne réalisons pas l’ampleur du décalage, car nous vivons dans un monde qui nous donne l’illusion de la modernité. Nous avons des smartphones, Internet, des voitures électriques. Mais nous les utilisons sans comprendre les principes qui les sous-tendent. Nous vivons en 2025 avec une compréhension du monde figée en 1850.
« Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » – Alvin Toffler (1970)
L’IA, un PhD en tout qui nous renvoie à notre insignifiance
L’IA ne souffre pas de ce retard. Elle assimile, connecte, analyse en temps réel des quantités de savoirs inaccessibles à un cerveau humain. Imaginons débattre avec une IA qui :
- Nous corrige sur une démonstration mathématique en utilisant une théorie publiée la semaine dernière,
- Explique en détail les derniers résultats en physique théorique,
- Fait une analyse pointue des tendances économiques en croisant instantanément 100 ans de données,
- Compare les grandes philosophies du monde avec des citations précises et des interprétations croisées.
Là où un humain passe des années à se spécialiser dans un domaine, l’IA accumule l’équivalent de plusieurs doctorats en quelques jours. Nous avons toujours cru que la créativité et la pensée complexe étaient notre dernier bastion. Mais même là, les modèles les plus avancés commencent à démontrer qu’ils peuvent générer des idées inédites, repérer des patterns que nous ne voyons pas, voire proposer des théories scientifiques.
Ce n’est plus une simple compétition de connaissances. L’IA nous met face à notre propre retard cognitif, et ça donne le vertige.
Nos modèles de pensée sont obsolètes
Nos institutions, nos entreprises, nos systèmes éducatifs… tout repose sur une vision du monde dépassée. Nous avons structuré nos sociétés autour de compétences que l’IA peut désormais surpasser.
À l’école : Nous continuons à former des jeunes à résoudre des équations quadratiques (méthodes de 1637) alors qu’ils vont devoir interagir avec des systèmes d’intelligence artificielle dans leur quotidien. Apprendre à coder ? Pourquoi pas. Comprendre comment l’IA raisonne et prend des décisions ? Bien mieux.
Dans l’entreprise : On pense encore en termes de “compétences métiers” figées, alors que les emplois eux-mêmes disparaissent, se transforment ou fusionnent sous l’effet de l’IA. On parle de digitalisation, alors que le vrai enjeu est l’adaptabilité cognitive et la capacité à évoluer en permanence.
Dans la société : Nous avons du mal à concevoir la vitesse des changements. Il y a dix ans, personne ne prenait l’IA au sérieux. Aujourd’hui, elle peut rédiger des rapports, coder des applications, générer des œuvres d’art et piloter des robots. Dans cinq ans, elle sera intégrée partout – et nous ?
Le jour où l’IA a pris le dessus sur l’esprit humain
Pendant des siècles, les échecs ont été considérés comme le sommet de la pensée stratégique humaine. Un jeu où seuls les plus brillants esprits pouvaient exceller. Puis, en 1997, Deep Blue d’IBM bat Garry Kasparov, le plus grand champion de l’époque. Un choc mondial. Kasparov lui-même oscille entre rage et stupéfaction : il accuse la machine de tricher, refuse d’admettre qu’un programme ait pu vraiment « penser ».
Puis vient AlphaGo en 2016, et cette fois, l’impact est bien plus profond. Cette IA de Google DeepMind ne se contente pas de calculer : elle développe des stratégies que personne n’avait jamais imaginées, jouant des coups qui défient les logiques humaines établies depuis des siècles. Lee Sedol, l’un des meilleurs joueurs de Go au monde, est ébranlé après sa défaite. Il qualifie un des coups de l’IA de « divin », et quitte la salle visiblement bouleversé. Quelques années plus tard, il annonce qu’il prend sa retraite : « L’IA a changé le jeu à jamais. Il n’y a plus rien à prouver.«
Et ce n’est que le début. AlphaZero, une version plus avancée, apprend sans aucune base de données, en jouant contre lui-même. En quelques heures, il domine toutes les IA précédentes et invente un jeu que plus aucun humain ne peut comprendre.
Ce n’était pas juste une défaite. C’était un effondrement psychologique.
Des génies qui avaient consacré leur vie entière à la maîtrise d’un art se sont soudain retrouvés face à une intelligence qu’ils ne pouvaient ni égaler, ni même appréhender.
Ce n’était pas seulement une question de calculs plus rapides. C’était un basculement existentiel.
Réapprendre à penser avant qu’il ne soit trop tard
Nous devons réagir avant d’être totalement dépassés. Cela signifie :
- Accepter que nos savoirs sont obsolètes et cultiver un apprentissage continu et orthogonal,
- Repenser l’éducation pour enseigner non pas des faits, mais une capacité à naviguer l’incertitude,
- Développer une culture où le doute, la curiosité et la remise en question sont valorisés,
- Former des leaders capables de comprendre la rupture technologique et d’adapter leur stratégie en conséquence.
Nous n’avons plus le luxe d’attendre. L’IA ne va pas ralentir. C’est nous qui devons accélérer.
« Être ou ne pas être », telle est l’IA en question.
Cette célèbre interrogation de Shakespeare date de plus de 400 ans. Et pourtant, c’est encore à elle que nous revenons pour exprimer nos dilemmes existentiels. Notre culture, nos références, notre manière de penser sont profondément ancrées dans des siècles passés. Pendant ce temps, l’IA avance à une vitesse exponentielle, non pas en s’appuyant sur des concepts d’hier, mais en intégrant en temps réel les savoirs les plus récents.
Si nous restons figés dans nos schémas d’hier, nous nous contenterons d’être spectateurs, dépassés par une intelligence qui apprend plus vite que nous.
Mais peut-être que réapprendre à penser, à douter, à nous adapter est encore possible. Peut-être que nous avons encore un rôle à jouer dans un avenir où l’humain ne s’accroche pas par inertie, mais trouve un nouvel équilibre.
Alors, être ou ne pas être à la hauteur de cette révolution ? Telle est désormais la vraie question.